
Monsieur le président,
Mes chers collègues,
Vous nous avez confié, il y a quelques semaines, une mission flash sur les aides à la presse régionale et locale. Nous avons choisi, avec ma collègue rapporteure, de traiter le sujet de façon large, en prenant en compte, au-delà des aides directes versées par le ministère de la Culture, tous les dispositifs de régulation susceptibles d’aider spécifiquement la presse régionale et locale, notamment dans le domaine de la publicité ou des annonces légales.
I. Je souhaiterais débuter cette présentation, si vous le voulez bien, par un rapide panorama de ce que l’on appelle la presse régionale et locale et des évolutions qu’elle a connues au cours de la dernière décennie.
La presse régionale et locale représente environ 420 titres d’information générale, qui traitent de façon prioritaire de l’actualité dans un cadre local, départemental ou régional. Parmi ces titres, on dénombre très exactement 62 quotidiens régionaux et environ 300 hebdomadaires régionaux ou départementaux, auxquels il faut ajouter quelques dizaines de magazines. Certains de ces titres ont un tirage très important : Ouest France est le premier quotidien français, loin devant Le Monde et Le Figaro.
La presse régionale et locale forme ainsi, en termes de diffusion, la première famille de presse, devant les quotidiens nationaux et les magazines. De fait, comme vous le savez, les Français lui accordent une confiance particulière par rapport à d’autres médias et, sur les quelque 50 millions de citoyens qui déclarent lire la presse chaque mois, 43 millions lisent les titres de la presse quotidienne régionale.
Au cours de la dernière décennie, la presse régionale et locale semble avoir mieux résisté que les autres familles de presse à la fermeture des points de vente, à l’érosion du papier et à l’arrivée des GAFA sur le marché publicitaire, en particulier local. Le nombre d’exemplaires distribués a certes diminué d’environ 30 % entre 2008 et 2018, mais c’est presque deux fois moins que le reste de la presse ; son chiffre d’affaires a baissé de 25 % sur cette même période, mais c’est également sans comparaison avec celui des autres familles de presse, dont le chiffre d’affaires a diminué de 42 %. Il est également à noter que si les recettes issues de la vente au numéro, comme les revenus tirés de la publicité et des annonces légales, ont beaucoup diminué, le chiffre d’affaires issu des abonnements a, pour sa part, augmenté.
Cependant, la presse régionale et locale a été lourdement frappée par la crise que nous traversons depuis un an :
– ses annonceurs locaux l’ont désertée, et ne sont pas encore prêts à consentir des dépenses publicitaires compte tenu des incertitudes qui pèsent sur leur avenir et des problèmes financiers qu’ils peuvent eux-mêmes rencontrer ; quant aux annonceurs nationaux, leur retour au deuxième semestre de l’année 2020 n’a pas permis de compenser la baisse globale de chiffre d’affaires publicitaire, qui atteint entre 20 % et 30 % pour les titres locaux par rapport à 2019 ;
– les recettes tirées de l’évènementiel, importantes pour certains groupes de presse qui y avaient vu la possibilité de diversifier leurs ressources, ont drastiquement chuté ;
– l’activité économique étant au ralenti, les ressources tirées des annonces légales ont aussi diminué ;
– les ventes au numéro ont été fortement affectées par la fermeture des points de vente (notamment ceux des aéroports et des gares) et les restrictions d’ouverture qu’ils subissent encore, notamment dans les centres commerciaux ;
– les rédactions ont dû se réorganiser, faute d’événements culturels, sportifs ou associatifs locaux à couvrir, afin de continuer à proposer des articles intéressants à leurs lecteurs et ne pas perdre leur lectorat le plus jeune, pour qui ces pages constituent parfois un élément important de la décision d’achat ou d’abonnement.
Le tableau que nous brossons peut paraître très noir, et il l’est pour l’ensemble de la presse. Une éclaircie est toutefois à signaler, avec la négociation récente d’un accord entre l’Alliance de la presse d’information générale et Google concernant les droits voisins des éditeurs de presse.
La simple reconnaissance par Google de l’existence de tels droits constitue en soi une victoire. Pour autant, le combat reste en large partie à mener, en particulier pour les titres régionaux et locaux qui n’ont pas tous un pouvoir de négociation équivalent à celui des grands titres de la presse quotidienne nationale. Il n’est hélas pas certain que la presse régionale et locale tire des bénéfices substantiels de ces nouveaux droits, à même de soutenir et favoriser la transition de leurs modèles économiques vers le numérique.
II. Beaucoup de titres locaux sont donc aujourd’hui dans une situation critique qui nécessite que l’on fasse le point sur les aides dont ils bénéficient.
1/ S’agissant, d’une part, des dispositifs pérennes :
La presse quotidienne régionale est majoritairement portée et bénéficie donc relativement peu, si l’on prend en compte les tarifs postaux préférentiels, du soutien financier de l’État par rapport à d’autres familles de presse. En revanche, elle a accès à l’aide au portage ainsi qu’au Fonds stratégique pour le développement de la presse (FSDP).
· L’aide au portage a été réformée en 2014 pour tenir compte de la progression du taux de portage. Au-delà de cette modification qui pénalise les titres bénéficiant déjà d’un taux de portage élevé, comme c’est le cas de la presse régionale, l’enveloppe financière a été très largement réduite au cours des dernières années, principalement pour des raisons budgétaires, passant de 70 millions d’euros en 2012 à 26,5 millions d’euros en 2021.
C’est bien peu au regard de ce qui est consacré chaque année à l’aide au postage des titres, à laquelle la presse régionale recourt, de facto, moins : environ 95 millions d’euros de compensation ont été versés par l’État au groupe La Poste en 2020, auxquels il faut bien sûr ajouter le déficit de 186 millions d’euros supporté par l’entreprise au titre de cette activité.
En définitive, le système de soutien à la distribution de la presse « abonnée » est aujourd’hui aussi considérable sur le plan financier que complexe dans son organisation, dans un contexte de forte diminution des volumes et de tensions parfois vives entre les acteurs.
Sur ce point, nous soutenons les propositions formulées par M. Emmanuel Giannesini, qui constituent une sortie « par le haut » à la crise que connaît le secteur. Rappelons qu’il préconise la simplification des aides au portage et au postage en une aide à l’exemplaire comportant deux barèmes, selon que l’exemplaire est porté ou posté. L’objectif est ainsi de trouver un juste équilibre entre le portage, qui a vocation à devenir la règle, et le postage, qui demeure indispensable dans les zones peu denses.
Dès à présent et pour préparer ces évolutions dans les meilleures conditions, nous souscrivons pleinement à la proposition faite par M. Giannesini de constituer un Observatoire de la qualité de la distribution de la presse, associant en premier lieu La Poste et les éditeurs de presse, mais aussi toutes les parties prenantes de la distribution. Cela permettra, notamment, de s’assurer que les titres qui devront encore recourir au postage – comme ce sera le cas des titres locaux en zone peu dense – bénéficieront d’une qualité de service supérieure à ce qu’elle est aujourd’hui. En effet, même si La Poste s’en défend, il est clair que le service rendu, s’agissant en particulier des hebdomadaires, n’est pas à la hauteur des enjeux auxquels la presse est aujourd’hui confrontée.
Par ailleurs, distribution et pluralisme sont étroitement liés au niveau local ; cette nouvelle instance devra donc, selon nous, prendre en compte l’effet de la qualité de la distribution sur la réalité du pluralisme au niveau local. Ainsi, l’Observatoire pourrait également produire chaque année, en lien avec les services du ministère de la Culture, un baromètre du pluralisme de la presse régionale et locale, notamment pour éclairer le débat que nous avons chaque automne sur l’efficacité des aides à la presse.
· Toujours en ce qui concerne les aides pérennes, nous nous sommes intéressées au Fonds stratégique pour le développement de la presse, qui a vocation à financer l’innovation du secteur – et notamment sa transformation numérique. Il s’avère toutefois difficile d’accès pour les petits éditeurs, car la bascule numérique nécessite souvent des investissements élevés qu’ils ne peuvent pas envisager. Si certains titres régionaux sont bien engagés dans la transition numérique, la majeure partie de la presse régionale et locale accuse encore un certain retard par rapport à la presse quotidienne nationale, et peine à monétiser leurs contenus en ligne et à susciter les abonnements numériques.
Cela a des conséquences sur l’accès au fonds de certaines publications, notamment les titres de presse spécialisée, puisque le fonds est théoriquement destiné à financer soit les titres IPG quel que soit le support, soit, pour les titres non-IPG, les innovations sur le numérique et non sur le papier. Par conséquent, les projets portant sur le financement d’une innovation bénéficiant à un service de presse en ligne non-IPG et à son pendant en version papier – autrement dit les projets bi-médias – subissent une réfaction de 50 % de l’assiette à partir de laquelle l’aide est calculée.
Or, le papier est encore un support capital pour la presse régionale et locale et, s’il faut accompagner sa transition numérique, il faut aussi tenir compte des habitudes de son lectorat et de son modèle économique actuel. Il nous apparaît donc souhaitable de revenir sur cette réfaction, afin d’augmenter le soutien aux titres qui ne peuvent pas basculer dès aujourd’hui vers le numérique.
· Il convient également de noter qu’il existe une aide au pluralisme des titres locaux, dotée d’1,4 million d’euros, qui bénéficie à un grand nombre de titres, pour une aide moyenne de quelques milliers d’euros. Elle apporte donc un soutien utile à beaucoup de très petites publications, qui ne sauraient sinon rentrer dans leurs coûts.
· S’agissant toujours des aides pérennes, je souhaiterais faire un point rapide sur la situation des titres ultra-marins. Les tensions que connaissent les titres régionaux et locaux dans l’hexagone y sont vraisemblablement exacerbées et la situation des titres qui existent encore dans les territoires ultramarins est très problématique.
De fait, ces titres apparaissent moins aidés que les titres métropolitains, alors même qu’ils connaissent des charges et des contraintes plus importantes, notamment en matière d’acheminement et de stockage des matières premières, dont le papier : dans les zones touchées par les cyclones, par exemple, il faut stocker l’équivalent de trois mois de papier pour pouvoir continuer à imprimer les titres.
Or, les critères de certaines aides directes à la presse font de facto obstacle à ce que les titres ultramarins y soient éligibles, notamment en raison du faible nombre de titres sur un même territoire, de leur forte dépendance aux annonces légales ou encore de la part plus faible des abonnements dans leurs revenus. C’est également une presse peu portée, qui bénéficie donc assez peu de l’aide au portage, et sa situation économique lui permet difficilement d’envisager des investissements éligibles au fonds stratégique…
L’aide pérenne et fléchée vers les titres ultramarins que le Gouvernement a proposée lors de la dernière loi de finances est ainsi particulièrement bienvenue. Toutefois, l’enveloppe budgétaire dont elle bénéficie, soit deux millions d’euros, apparaît dérisoire face aux besoins des éditeurs et en comparaison des aides dont bénéficient les titres hexagonaux.
Il nous apparaît dès lors nécessaire :
– d’une part, de pérenniser et d’augmenter cette aide qui pourrait être analysée comme une compensation des charges supplémentaires que subissent les titres ultramarins du fait de leur situation géographique ;
– d’autre part, de faire en sorte, par des mécanismes dérogatoires le cas échéant, que les autres dispositifs d’aide puissent également bénéficier aux titres ultramarins.
Par ailleurs, il ressort des auditions menées que les titres ultra-marins sont trop souvent délaissés par les grandes campagnes nationales de communication menées par l’État. Ce n’est pas satisfaisant, autant pour l’écho que doivent rencontrer ces campagnes dans les Outre-mer que pour les ressources de la presse locale. Nous appelons par conséquent les services de l’État à veiller à ce que les titres en question soient bien sollicités.
2/ S’agissant d’autre part des aides exceptionnelles attribuées du fait de la crise ou dans le cadre du plan Filière :
Des aides exceptionnelles ont également été décidées dans le cadre des plans d’urgence liés à la crise sanitaire et du plan de soutien à la filière Presse.
Au titre des mesures d’urgence, 106 millions d’euros d’aides exceptionnelles ont été votées en juillet dernier afin de garantir la continuité de la distribution de la presse et de soutenir les éditeurs et diffuseurs les plus fragiles.
À cela, il faut ajouter le nouveau crédit d’impôt de 30 % sur le premier abonnement à un titre d’information politique et générale, pour lequel nous attendons toujours le feu vert des autorités européennes.
Ce sont ensuite 140 millions d’euros qui ont été débloqués à l’automne, dans le cadre du plan de soutien à la filière Presse.
Parmi les mesures les plus significatives pour la presse régionale et locale, nous retenons en premier lieu la création d’un fonds de transformation des imprimeries de la presse régionale doté de 18 millions d’euros, qui permettra d’accompagner la restructuration du secteur dans un contexte de baisse continue des tirages.
On peut également noter le renforcement du fonds stratégique pour le développement de la presse à hauteur de 25 millions d’euros par an ; le doublement de l’aide à la modernisation des diffuseurs, qui atteint désormais 12 millions d’euros par an ; et enfin, la création d’un fonds de lutte contre la précarité, doté de 18 millions d’euros. Il faudra bien sûr s’assurer que ces dispositifs bénéficient également à la presse régionale et locale.
Il s’agit là d’un plan massif en faveur non seulement des imprimeries, mais également de l’ensemble de la filière ; à ce titre, il constitue peut-être l’occasion de s’interroger sur les aides à la presse dans leur ensemble. Ce n’est pas le sujet de notre mission à proprement parler, mais il nous semble que ces aides ont peut-être perdu, au fil du temps, en lisibilité, si ce n’est en sens.
Cet afflux de crédits mériterait que l’on réfléchisse à nouveau aux objectifs poursuivis par l’ensemble de ces dispositifs, et que l’on s’attache à rechercher une forme de simplification. Qui doit être aidé ? La notion d’information politique et générale nous paraît à la fois trop large dans son application et trop étroite dans sa définition, car d’autres familles de presse, comme la presse de vulgarisation scientifique ou historique ou encore la presse professionnelle, relèvent pour nous d’un intérêt citoyen et méritent à ce titre d’être soutenus par les pouvoirs publics.
De fait, c’est la notion de presse d’information politique et générale qui peut, dans certains cas, susciter un moindre soutien étatique à la presse locale. Je pense par exemple à la presse agricole, véritable presse des territoires, qui ne bénéficie pas de cette qualification et se trouve donc pénalisée tant en matière d’aides directes que de tarifs postaux – ce qui est d’autant plus pénalisant que La Poste est leur seul moyen de distribution. S’il est normal que l’État cible ses aides sur une forme de presse qui contribue à la qualité du débat démocratique, on peut tout de même s’interroger sur l’attribution de la qualification « IPG » à certains titres de presse qui se trouvent, par ce biais, parmi les plus aidés.
Les représentants des journalistes que nous avons entendus dans le cadre de nos travaux ont également insisté sur la nécessité de conditionner l’octroi des aides publiques à l’exemplarité des entreprises bénéficiaires en matière sociale : cela paraît effectivement souhaitable et s’inscrit pleinement dans les réflexions sur la conditionnalité des aides publiques récemment menées sous la présidence de notre collègue Stéphane Viry.
Les missions conduites par M. Emmanuel Giannesini et Mme Laurence Franceschini pourraient ainsi constituer des bases utiles pour entamer une réflexion que nous appelons de nos vœux visant à refondre, simplifier, repenser les aides à la presse dans leur ensemble. Peut-être pourrions-nous, du reste, commencer par une table-ronde sur ce sujet au sein de notre Commission, monsieur le président ?
· Du reste, une transparence accrue sur l’attribution des aides à la presse serait bienvenue. En effet, le ministère de la Culture avait pris l’habitude de publier chaque année le montant des aides attribuées à chaque titre et groupe de presse, mais il a récemment rompu avec cette pratique. Les dernières données disponibles datent de 2017, ce qui peut entretenir la méfiance de certains à l’égard de telles aides.
Nous suggérons donc que cette habitude devienne une obligation, et que ces données soient publiées dans le cadre du débat budgétaire que nous avons chaque automne. Un document budgétaire spécifique, prenant par exemple la forme d’un « jaune », pourrait même être consacré au soutien de l’État en faveur de la presse, afin d’éclairer les parlementaires que nous sommes sur la façon dont les crédits que nous votons, dans l’ensemble des missions concernées, sont attribués aux titres. Pourraient notamment être intégrées dans ce cadre les aides indirectes au postage matérialisées par le déficit de La Poste et la compensation du budget général, avec l’objectif de pouvoir mesurer plus finement le soutien réel dont chaque titre bénéficie.
Il en va de même pour les aides versées par les régions au titre de leur compétence en matière économique. Il nous semble essentiel d’aller vers davantage de transparence sur ces aides, afin de s’assurer qu’elles sont attribuées en toute impartialité et qu’elles contribuent à la poursuite de l’objectif de pluralisme de la presse sur le territoire.
III. Au-delà des dispositifs d’aides directes et indirectes dont bénéficient les entreprises de presse régionale ou locale, il apparaît nécessaire de mener une réflexion sur leur environnement et sur les conditions de leur équilibre financier.
Les ressources de ces titres sont structurellement en diminution, qu’il s’agisse des recettes issues de la vente au numéro, des annonces légales ou de la publicité. Nous entendons formuler plusieurs propositions pour leur permettre de retrouver quelques marges de manœuvre.
· S’agissant tout d’abord de la vente au numéro, il est nécessaire de s’assurer que la presse régionale et locale soit aussi accessible que possible sur le territoire qu’elle couvre. Bien sûr, le numérique peut constituer un formidable levier dans ce domaine, mais il faut garder à l’esprit que son lectorat est encore très attaché au papier. Il importe dès lors de faciliter, dans un contexte de fermeture d’un nombre croissant de marchands de presse, la distribution de la presse locale au cœur des territoires.
Jusqu’alors, des commerces de proximité comme les boulangeries permettaient aux lecteurs, dans bien des cas, d’avoir facilement accès à la presse locale. Cependant, ils sont de plus en plus souvent remplacés par des grandes surfaces, hard discounters, qui refusent de distribuer la presse. Il nous semble donc qu’il serait d’intérêt public que ce critère puisse être pris en compte lors de la délivrance de l’autorisation d’ouverture par la commission départementale d’aménagement commercial, en particulier lorsque le territoire constitue une « zone blanche » en matière de distribution de la presse. Si tel n’est pas le cas, et que la presse est correctement distribuée au sein de ce territoire, alors ce critère pourra bien sûr être écarté par la commission.
Valoriser la presse locale nécessite aussi de la faire connaître au public de demain, à savoir les plus jeunes. C’est d’ailleurs l’objectif poursuivi par le ministère de l’Éducation nationale pour l’ensemble de la presse avec la Semaine de la presse, organisée chaque année dans les écoles. Il nous semble toutefois utile de renforcer les partenariats entre l’Éducation nationale et les éditeurs locaux afin d’assurer la promotion de leurs titres, par exemple par la distribution d’exemplaires gratuits.
· S’agissant des annonces légales, elles relèvent toujours du quasimonopole de la presse locale et représentent parfois une part importante des ressources des entreprises de presse concernées. La loi PACTE a apporté deux modifications susceptibles d’avoir un impact non négligeable sur les titres existants, et sur lesquelles nous nous sommes penchées.
La première modification réside dans la possibilité désormais offerte aux services de presse en ligne (SPEL) de publier des annonces légales. Ceux-ci doivent, comme les journaux papier, comporter un volume substantiel d’informations originales dédiées au département et renouvelées sur une base au minimum hebdomadaire pour être habilités par les préfectures à recevoir lesdites annonces – et être rémunérés pour cette activité.
Or, il est apparu au cours de nos auditions que cette ouverture aux services en ligne avait pu conduire à l’émergence de pratiques abusives.
Il est clair que certains SPEL ne couvrent pas aujourd’hui de façon hebdomadaire l’actualité de l’ensemble des départements dans lesquels ils sont habilités et qu’ils détournent dès lors des ressources qui devraient revenir à des titres qui couvrent réellement l’actualité locale.
Il est possible que les préfectures aient eu des difficultés, au moment de l’examen de leurs dossiers, à évaluer le critère lié au volume substantiel d’informations locales présenté par ces mêmes titres ; on peut également supposer qu’une fois l’habilitation délivrée, ces titres n’aient pas continué à couvrir avec autant d’assiduité l’actualité du département en question.
Dès lors, il nous semblerait opportun de faire intervenir la Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP), qui a évidemment toute les compétences requises pour apprécier un tel critère. Les préfectures pourraient ainsi la saisir pour qu’elle rende un avis sur le respect, ou non, de ce critère par les titres de presse demandeurs d’une habilitation. Elle pourrait également être dotée d’un pouvoir de révision, comme c’est aujourd’hui le cas s’agissant des agences de presse et des SPEL, afin de proposer aux préfectures de retirer leur habilitation aux titres qui ne respecteraient plus ce critère. Ainsi, un meilleur contrôle serait assuré a priori comme a posteriori. Bien sûr, confier une nouvelle mission à la CPPAP suppose de renforcer ses effectifs en conséquence.
La deuxième modification apportée par la loi PACTE est le principe d’une forfaitisation du tarif des annonces légales, d’ores et déjà mis en œuvre pour les annonces liées à la création d’entreprises. Il est également prévu que ces tarifs diminuent au cours des prochaines années, afin d’alléger le poids financier que ces annonces peuvent représenter pour les entreprises concernées. Toutefois, un gel a été décidé pour l’an dernier puis reconduit pour 2021, afin de ne pas perturber un secteur – celui de la presse locale – déjà fragile. Nous sommes favorables à ce que ce gel soit reconduit en 2022, afin de laisser aux entreprises de presse le temps de traverser la crise.
Enfin, il semble qu’un problème particulier soit posé par les plateformes qui servent d’intermédiaires entre les éditeurs et les entreprises. Il nous a été signalé lors de nos auditions que certaines plateformes exigeaient une commission d’un montant disproportionné, atteignant jusqu’à 75 % du tarif légal. Cela nécessite, à notre sens, qu’une enquête soit rapidement conduite par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou l’Autorité de la concurrence, car de telles pratiques commerciales pourraient être considérées comme abusives.
· En matière de publicité, il est à noter que la presse régionale et locale bénéficie encore aujourd’hui d’une forme de protection étatique de son marché publicitaire, puisque certains secteurs, en particulier celui des opérations commerciales de la grande distribution, ne sont pas accessibles aux chaînes de télévision.
Des évolutions règlementaires récentes ont permis aux chaînes de télévision de faire de la publicité segmentée, c’est-à-dire de proposer des publicités différentes en fonction du territoire, ce qui soulève quelques inquiétudes parmi les éditeurs de presse locaux. Même si des précautions ont été prises pour préserver autant que possible leur marché publicitaire
– aucune adresse précise ne peut notamment être fournie par le biais de la publicité en question –, il n’est pas impossible que cette réforme ait à terme des répercussions sur les relations qu’entretiennent les titres locaux avec les annonceurs, locaux comme nationaux. Il faudra donc en faire le bilan dans quelques temps, pour s’assurer que la peau de chagrin que constitue le marché publicitaire local n’a pas été captée, après Google et Facebook, par les chaînes de télévision.
· Au-delà, la piste d’un crédit d’impôt favorisant les investissements publicitaires au sein des médias avait été esquissée l’an dernier pour remédier aux effets de la crise. La proposition, qui visait les annonceurs de toutes tailles, était vraisemblablement trop large pour être retenue par le Gouvernement, qui craignait un effet d’aubaine trop important.
Il nous semble toutefois que le mécanisme est intéressant, et particulièrement pertinent en matière de presse. En effet, si l’on souhaite inciter les annonceurs locaux à faire à nouveau la publicité de leurs produits et services au sein des titres locaux de presse, une mesure de cette nature nous paraît doublement efficace : elle permettrait à la fois d’aider les titres de presse locaux à retrouver un niveau de ressources suffisant et de soutenir les entreprises locales en favorisant la relance de leurs activités. L’effet d’aubaine nous semble limité, car les petites et moyennes entreprises de nos territoires sont aussi celles qui ont renoncé à des investissements publicitaires dans la presse, préférant, quand cela leur était encore possible, une publicité en ligne moins onéreuse.
· S’agissant toujours des ressources, les droits voisins pourraient constituer une source de revenus non négligeable pour beaucoup de titres locaux. Encore faut-il que tous puissent conclure un accord avec les géants américains qui relayent leurs articles et que ces accords soient respectés. Dans ce domaine, nous souhaitons attirer l’attention du Gouvernement sur la nécessité de s’assurer que toutes les familles de presse – même non IPG – puissent bien conclure un tel accord, dans des conditions équitables, et qu’un tiers de confiance soit désigné afin de certifier les données transmises par les opérateurs de plateforme en ligne. C’est à ces deux conditions que les droits voisins récemment reconnus aux éditeurs pourront réellement bénéficier aux acteurs de la presse locale.
· Enfin, nous souhaitons attirer l’attention sur les évolutions récentes en matière d’éco-contribution des éditeurs de presse et aux conséquences de la directive « Déchets » telle que transposée par la loi dite « Agec » de février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.
Rappelons que dans le cadre de la responsabilité élargie des producteurs de la filière papier, les titres de presse sont tenus depuis 2017 de verser une contribution à un organisme agréé pour gérer la collecte, la valorisation et l’élimination des déchets papiers. Cette contribution peut être versée soit en espèces, soit en nature par l’insertion d’encarts publicitaires portant sur le tri et le recyclage du papier, ce qui permet d’ailleurs de mener des campagnes en faveur de l’environnement efficaces et à moindre frais. La loi Agec met fin à cette contribution en nature, avec une date butoir fixée au 1er janvier 2023.
C’est une vraie source d’inquiétude pour les éditeurs, pour qui le coût de cette mesure pourrait atteindre un total de 25 millions d’euros. Dans le contexte de crise que connaît la filière, cette charge financière nouvelle nous semble préoccupante.
Elle l’est d’autant plus que la directive « Déchets » n’interdit pas explicitement la contribution en nature ; en ce sens, l’interprétation qui en a été faite lors de la loi Agec nous semble mériter un réexamen. Nous souhaitons donc que le ministère de la Culture réinterroge la Commission européenne sur l’interprétation de la directive, afin de tirer ce sujet au clair et rassurer le secteur.
17





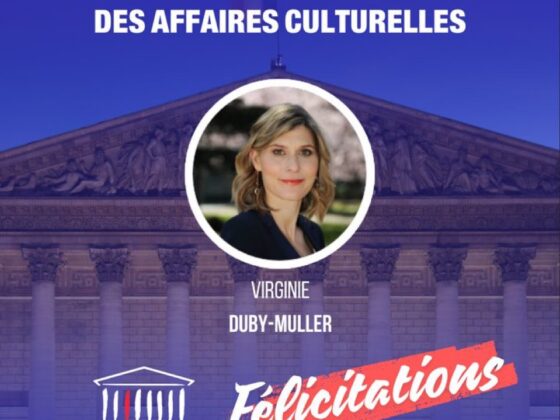

Vous devez êtreconnecté pour poster un commentaire.